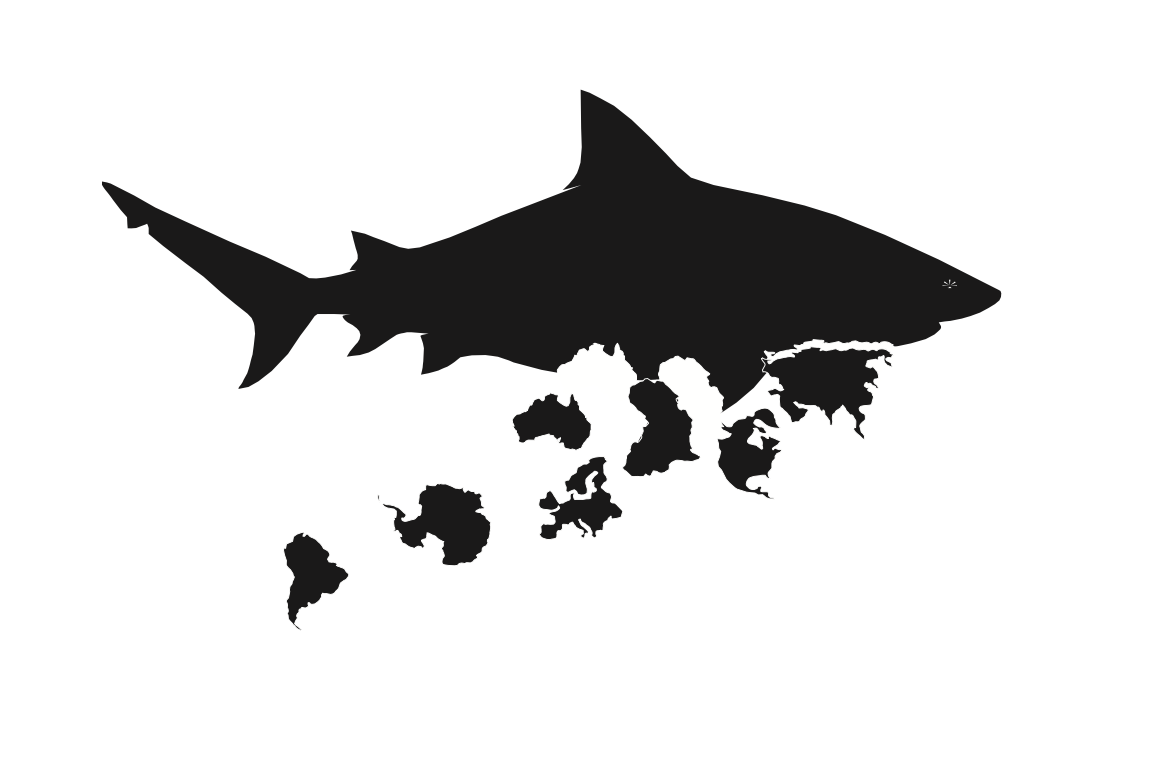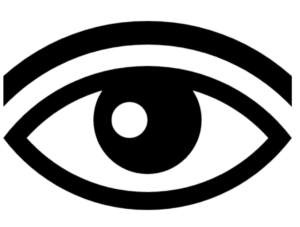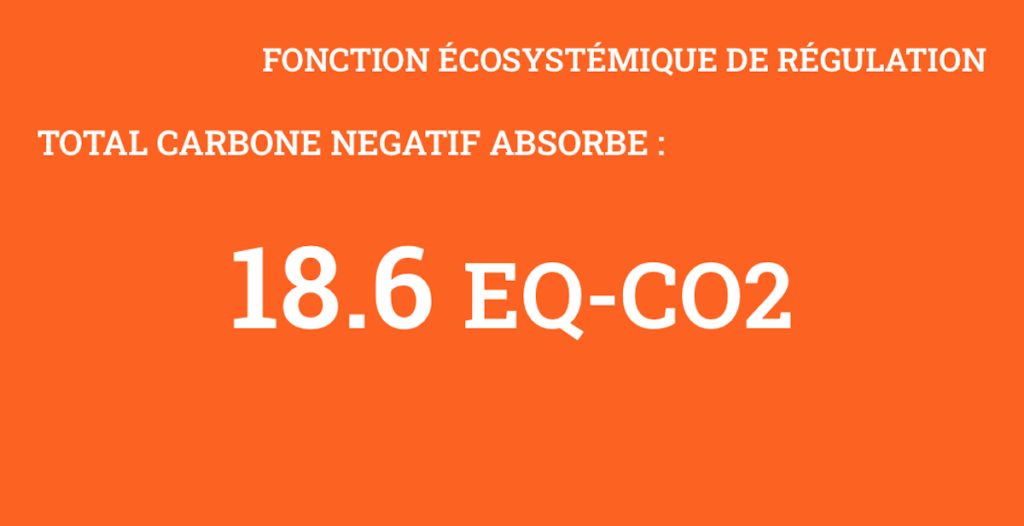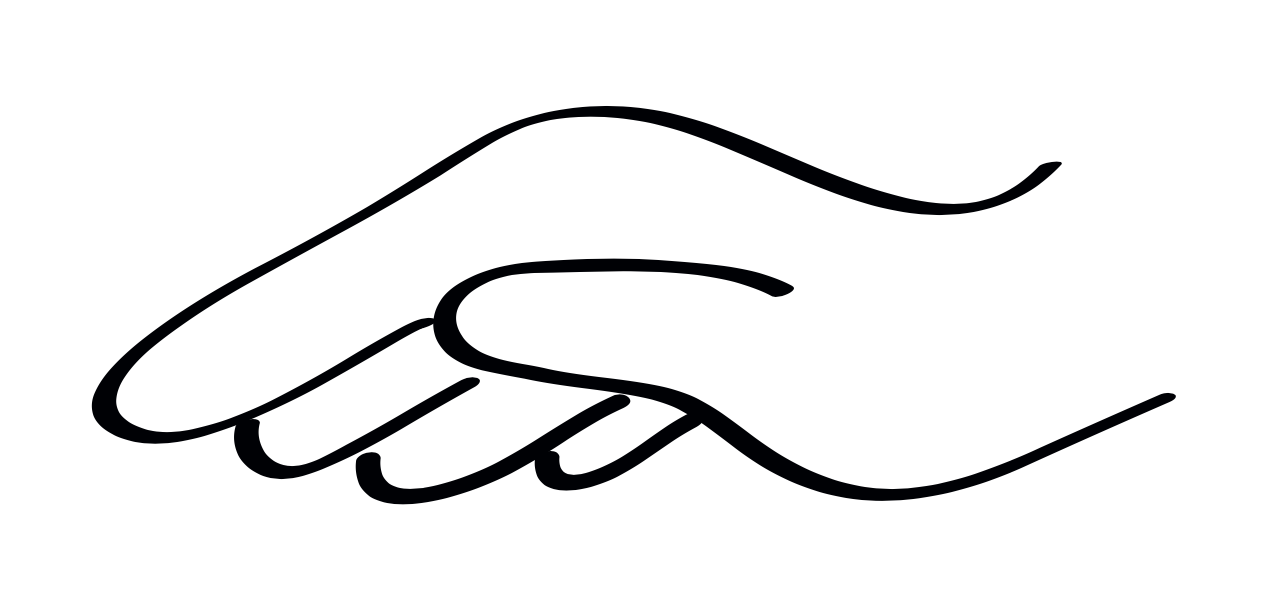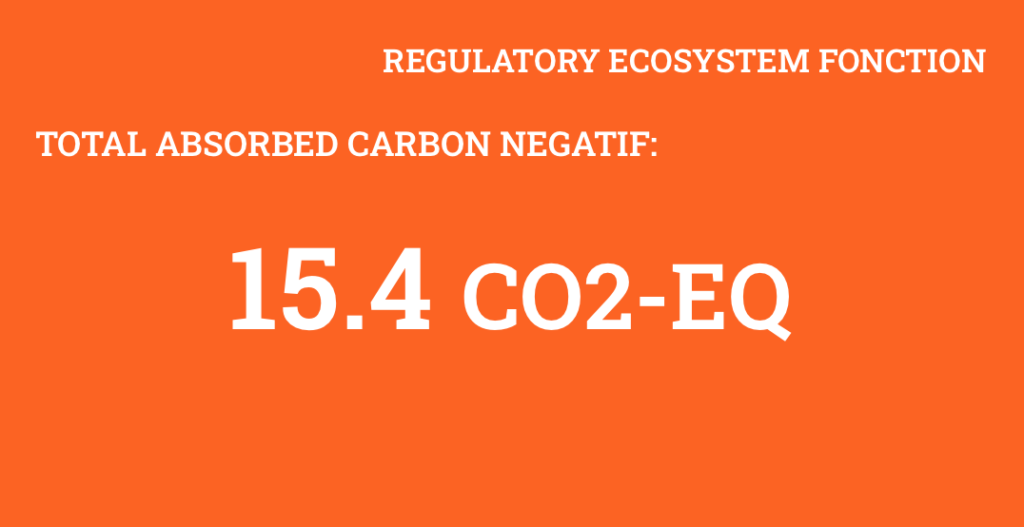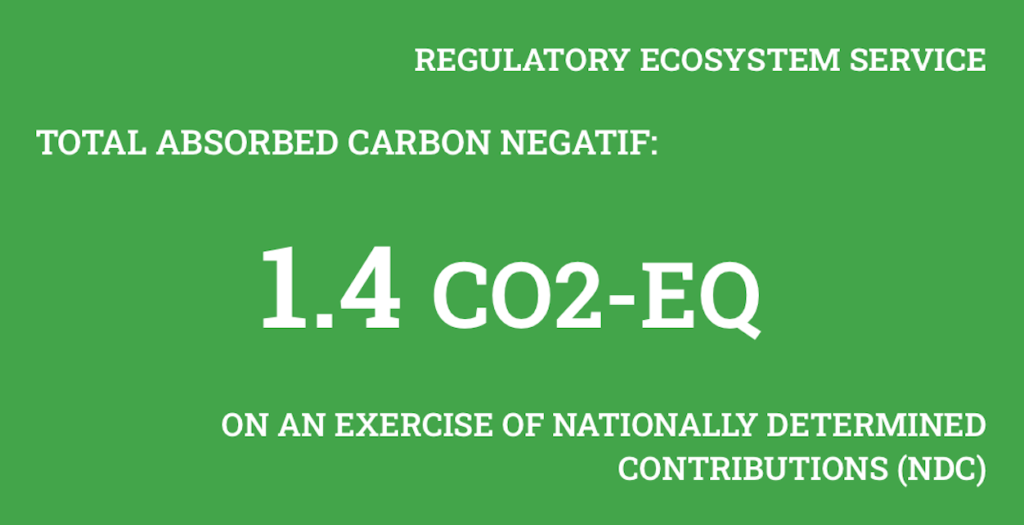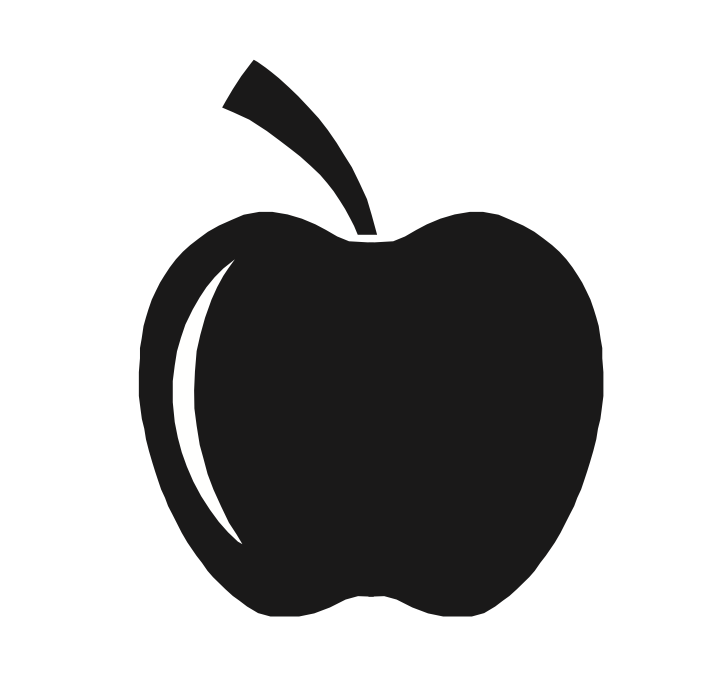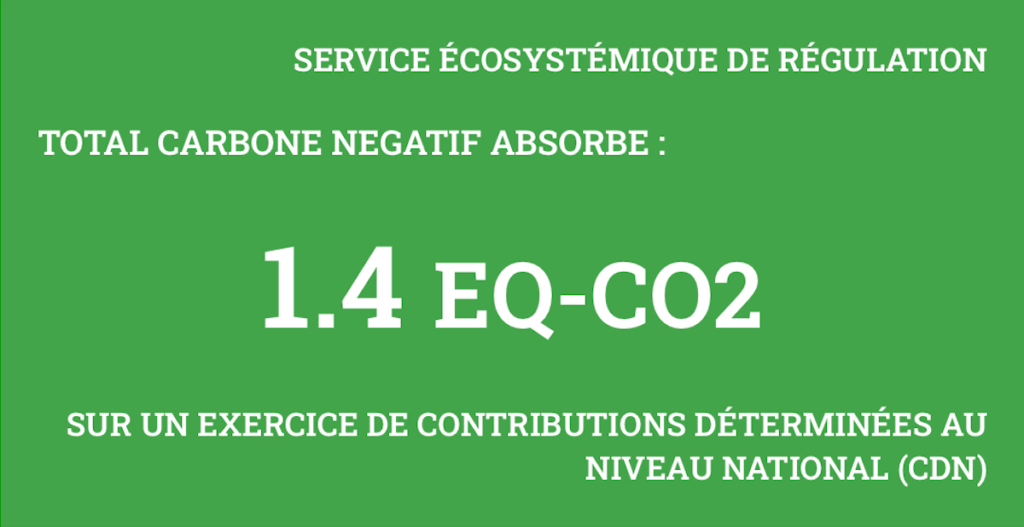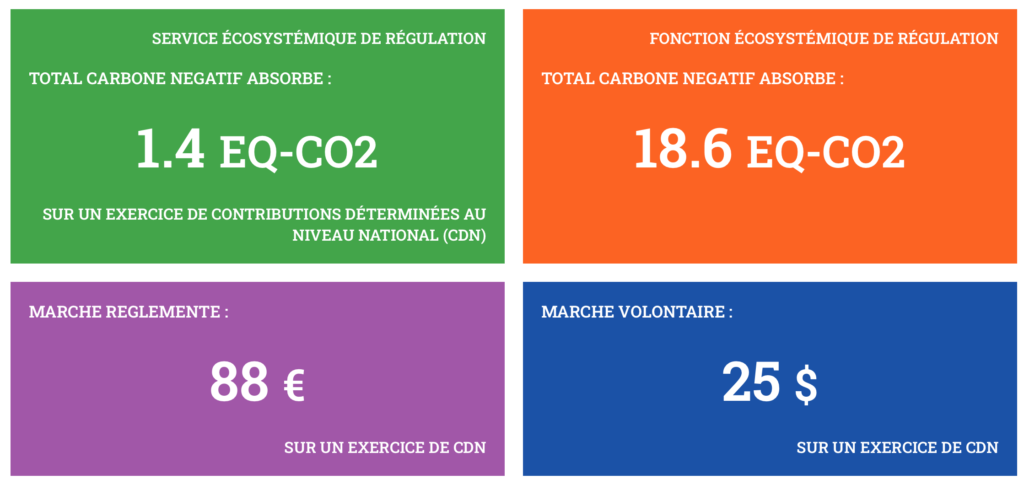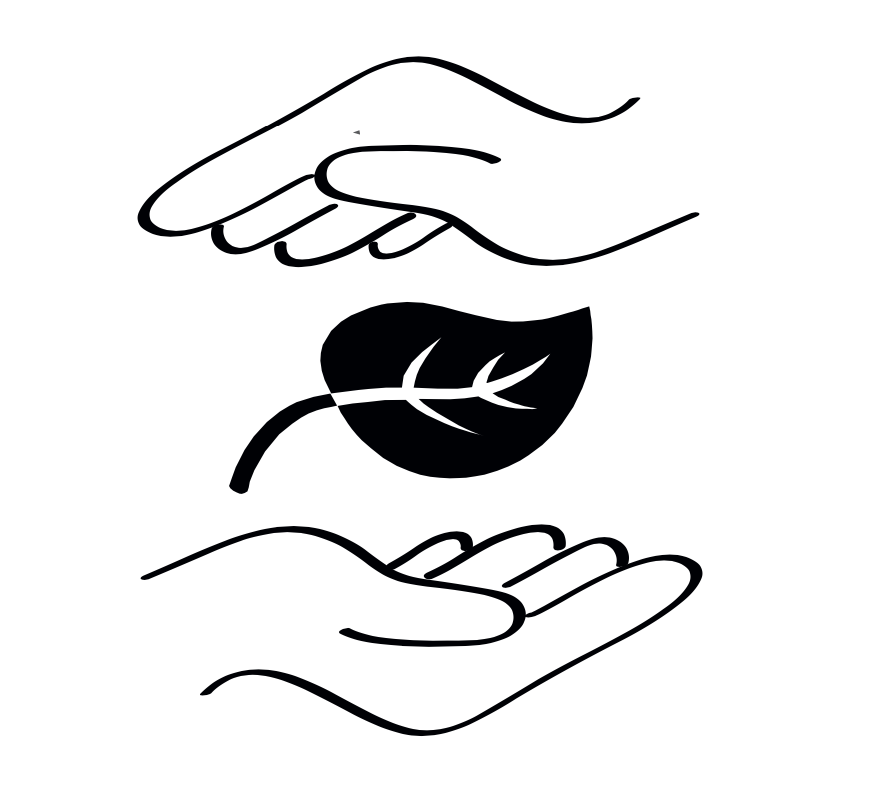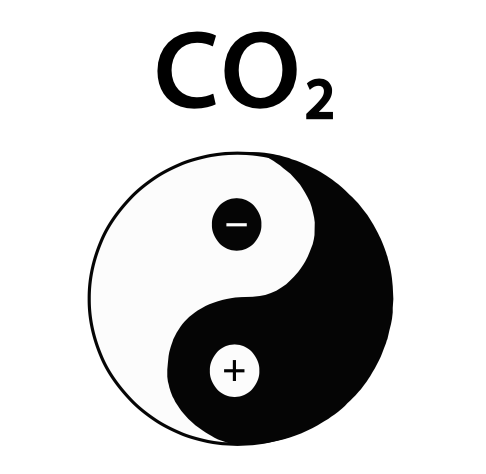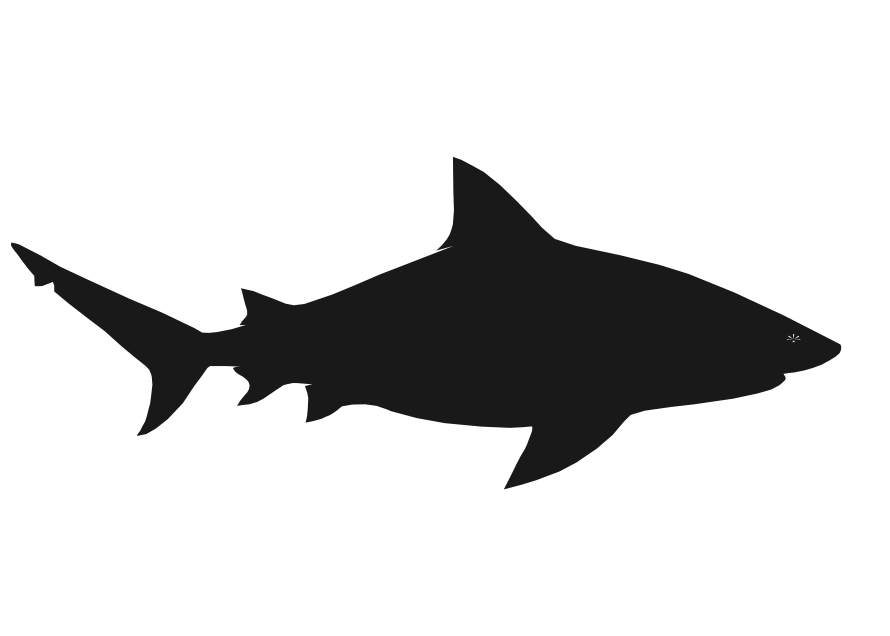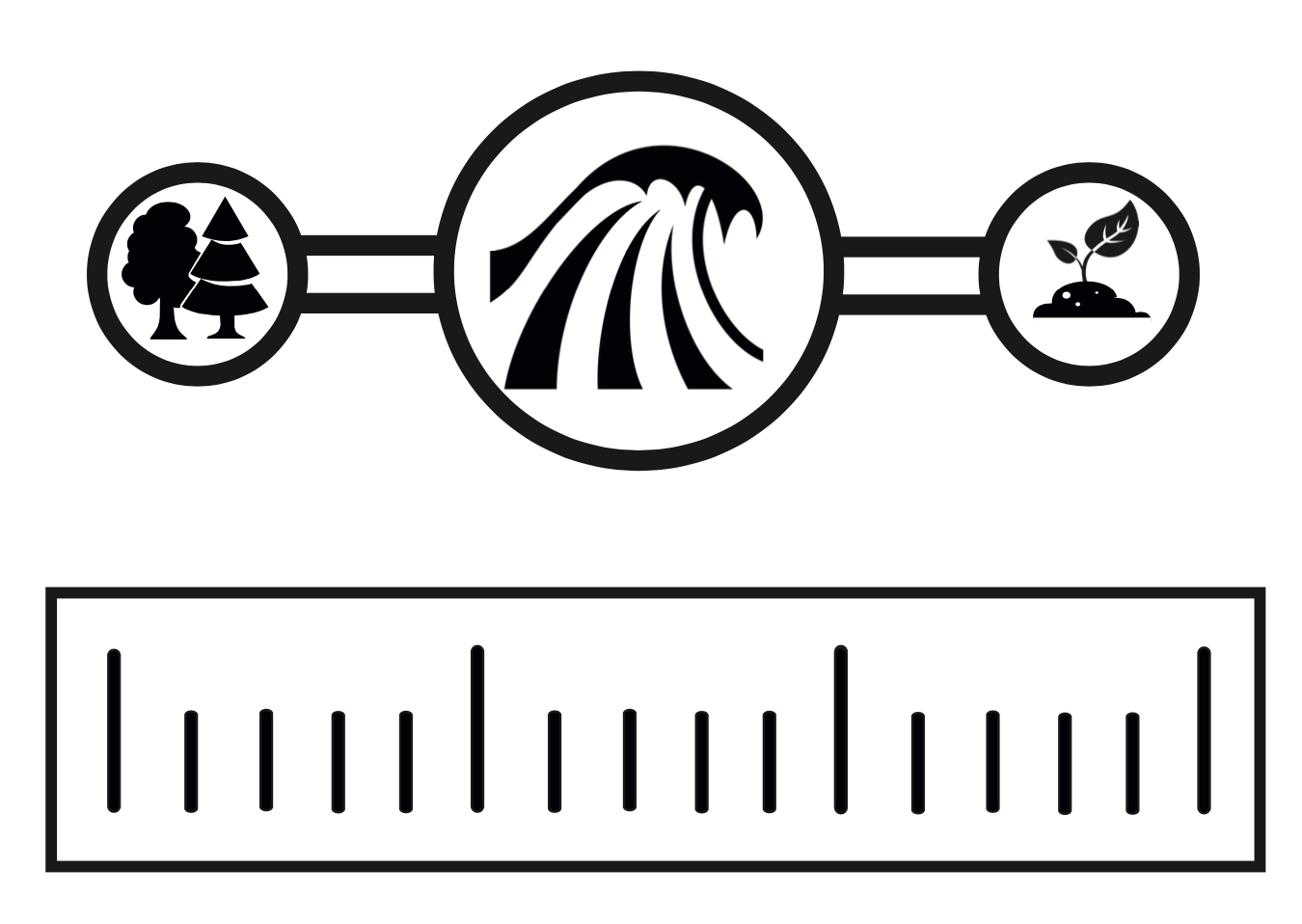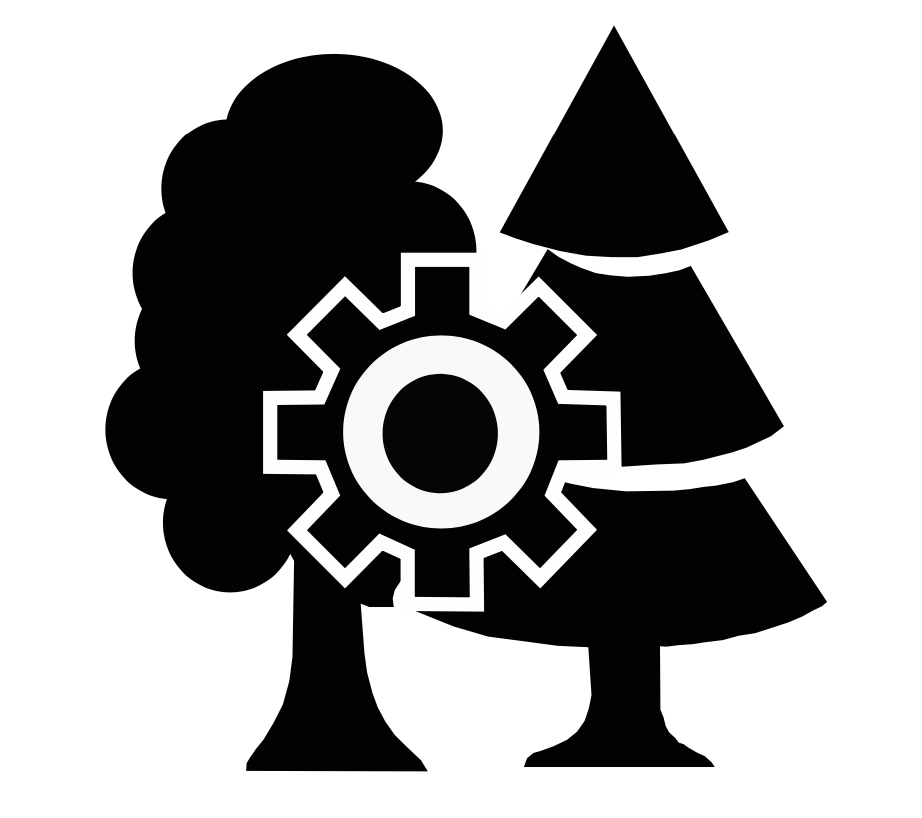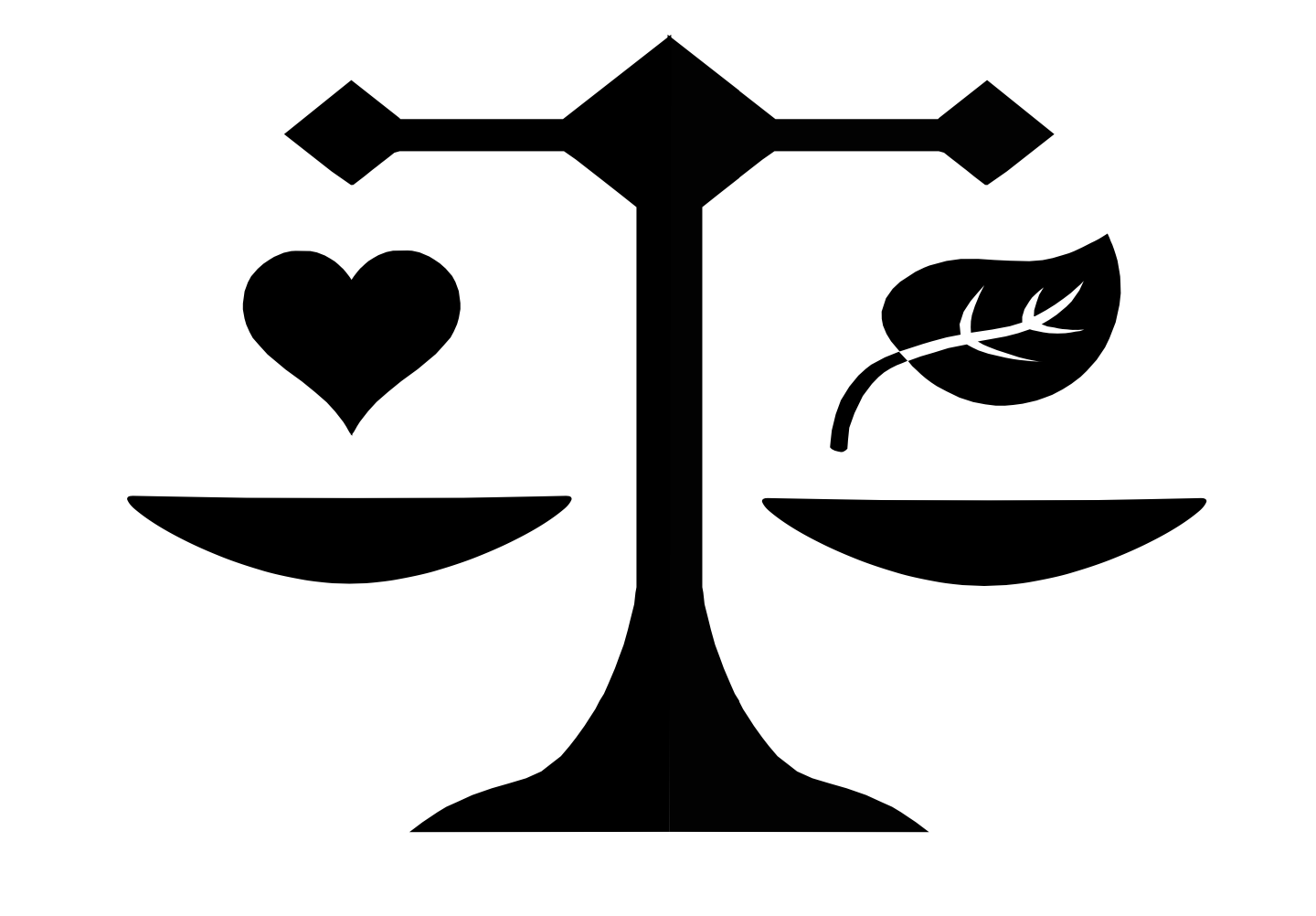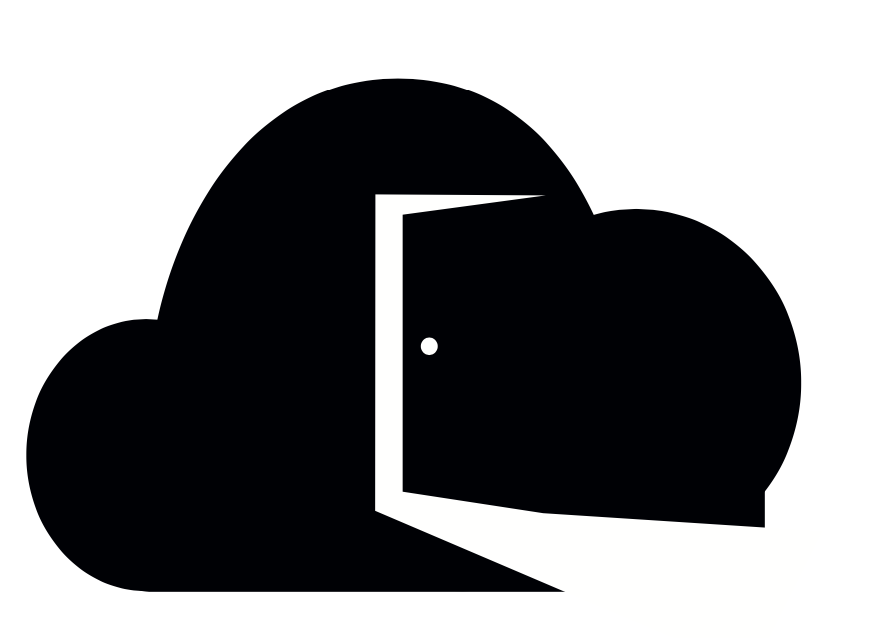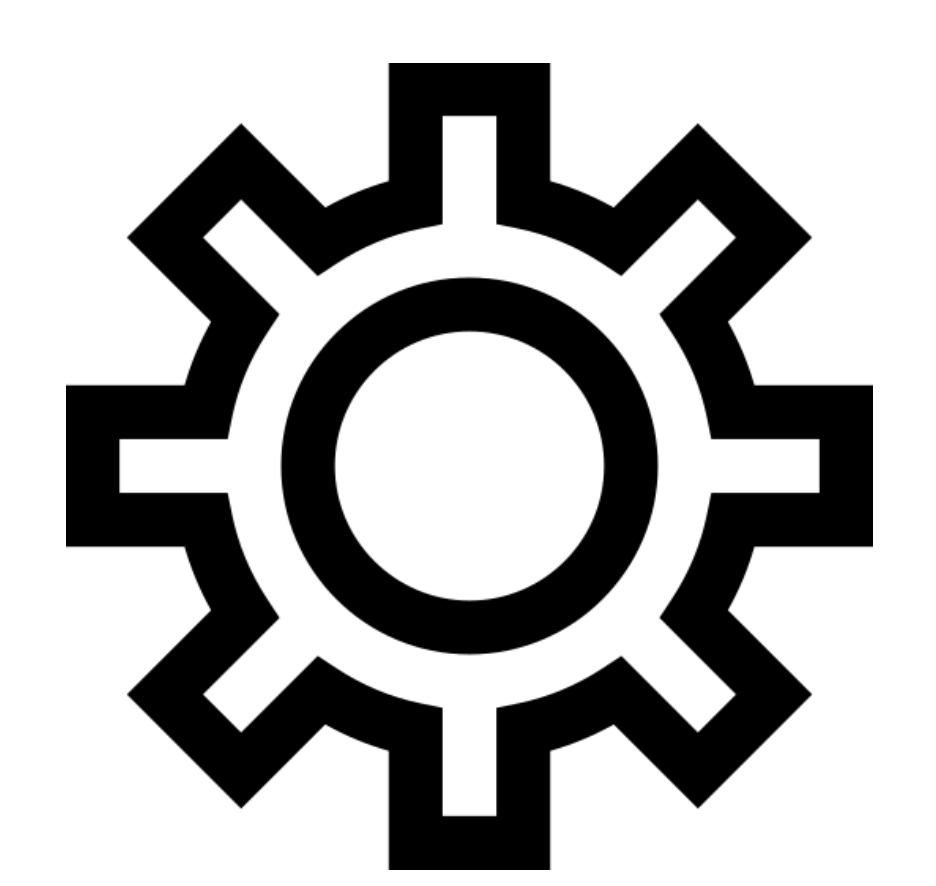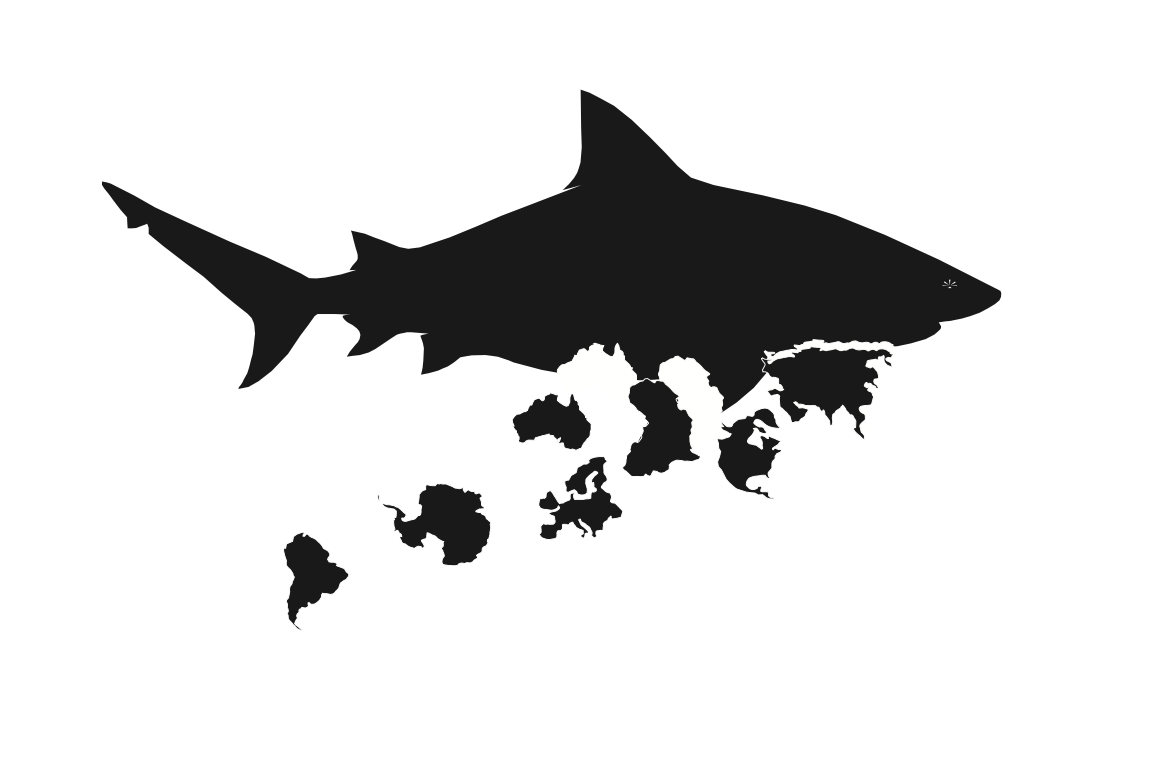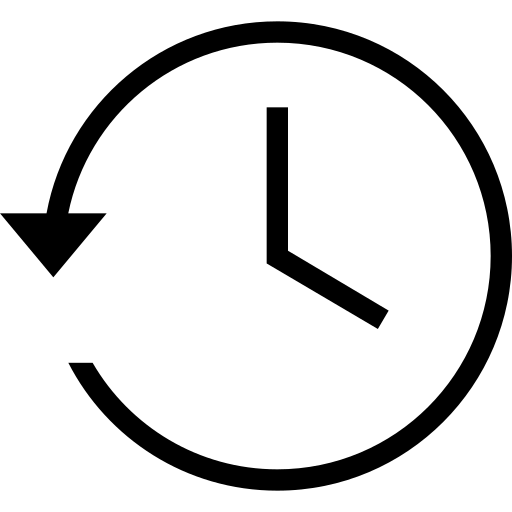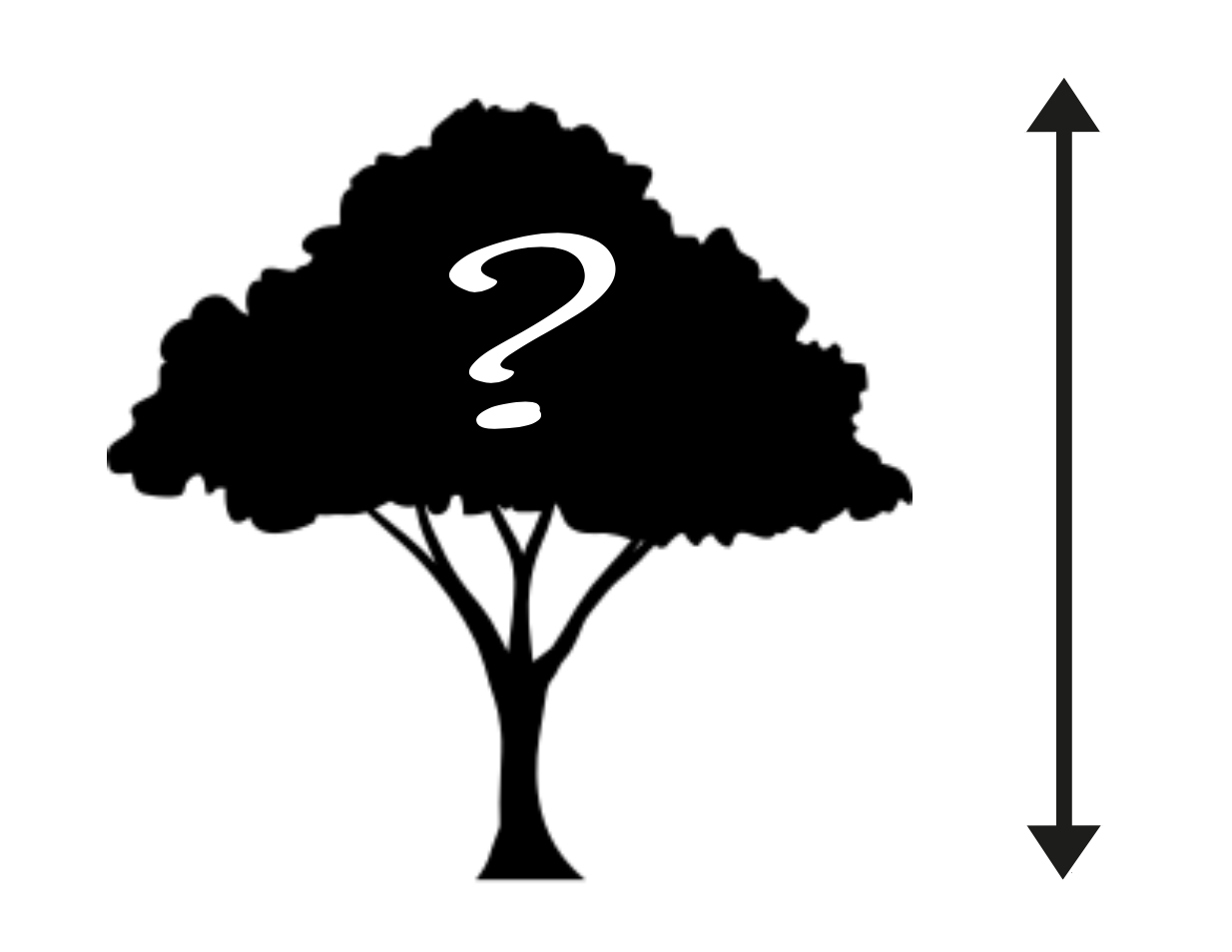La portée générationnelle
des Puits de carbone organiques
Par Frédéric Dietrich – 24/10/2024.
Le carbone absorbé par le processus des Puits carbone ne reste pas séquestré éternellement dans le réservoir. En effet, le stockage du carbone est circonscrit à une temporalité que l’on nomme : le temps de résidence. Allant de la journée aux millions d’années, l’atténuation des changements climatiques orchestrée par cette temporalité des Puits de carbone touchera, soit les générations présentes, soit les générations futures. C’est pourquoi nous parlerons du principe des équités générationnelles.
De plus en plus, il nous est donné l’occasion d’entendre qu’il faille sauver le climat pour les générations futures. Mais, y a-t-il un sens à brandir les générations futures et non nées en éludant les générations présentes et actuelles qui elles aussi subissent les affres sociales et climatiques ? Est-ce que ce ne sont pas les générations présentes qui engendrent les générations futures ? Bien que le développement durable soit venu unifier les générations présentes et futures, une différence notable s’instruit entre ces générations qui ne jouissent pas des mêmes droits. La primauté revienne aux générations présentes et actuelles, ces dernières ont un devoir de protection vis-à-vis des générations futures non nées.

Le « Temps de résidence », cette nature juridique qui fonde la portée générationnelle des Puits de carbone
Si l’on se réfère à sa définition, un Puits de carbone compte trois natures juridiques (Dietrich, 2022). Le processus, d’abord, qui absorbe le carbone atmosphérique directement ou indirectement. Le réservoir, ensuite, qui stocke le carbone absorbé par le processus. Et enfin, le temps de résidence qui représente le temps de séquestration du carbone dans le réservoir.
Cette temporalité est très variable selon les Puits de carbone. Du Puits-Sol au Puits-Océan, le temps de résidence du carbone dans le réservoir varie, respectivement, du million d’années à mille ans. Pour ce qui est du Puits-Forêt et du Puits-Biodiversité, le carbone – qui est le matériau du vivant – est stocké le temps de l’espérance de Vie de l’Être dont il est question, c’est-à-dire de la journée à la centaine d’années. On note alors une forte variabilité de séquestration du carbone dans le réservoir, de quoi fonder le principe de différenciation chez les Puits de carbone.
Mais un autre principe vient également s’inviter à la notion de Puits de carbone. En effet, considérant la variabilité temporelle du temps de résidence allant de la journée aux millions d’années, l’atténuation des changements climatiques va concerner diverses tranches générationnelles. Pour le Puits-Sol et le Puits-Océan, les vertus temporelles de séquestration des Puits vont toucher davantage les générations futures, alors que les bienfaits du Puits-Forêt et du Puits-Biodiversité vont s’adresser en priorité aux générations présentes. Parce que les vertus des Puits de carbone relèvent autant des générations présentes que des générations futures, nous parlerons du principe des équités générationnelles.
Intimement liés, nous remarquons que les principes de différenciation et des équités générationnelles sont régulièrement cités d’un seul tenant en droit (art. 3§1, CCNUCC 1992 ; art. L. 110-1-II, Code de l’env.).
Le développement durable, un principe qui conjugue les générations présentes aux générations futures
Si la notion de générations futures en droit a été remarquablement étudiée et éprouvée par la doctrine (Gaillard, 2011), l’intrication entre générations présentes et futures – tout comme sa portée juridique – reste encore toujours indicible.
Pour agréger les intérêts des générations présentes à ceux des générations futures, il était alors indispensable qu’un autre principe puisse être en mesure de lier ces intérêts. Bien connu du grand public, ce principe est celui du développement durable. Il est communément admis que le Rapport Brundtland (1987) soit à l’origine de l’émergence de ce principe dans le droit.
Afin que les générations présentes et futures se tendent la main, il est indispensable que l’accès et la jouissance aux ressources de notre planète se perpétuent dans le temps. À ce titre, notre célèbre article L. 110-1-II du Code de l’environnement agrège les intérêts générationnels entre eux : « l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
Indubitablement, le principe de développement durable sert de jonction aux intérêts des générations présentes et futures. Il suppose une gouvernance raisonnée des ressources présentes et actuelles afin qu’elles puissent également profiter aux générations futures et non nées.
Pour autant, il semble que ce principe ne soit pas une innovation juridique du club de Rome, tant s’en faut. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »… Tout comme en sciences, le droit ne se crée pas de toutes pièces. Il se transforme, s’inspire des précédents pour se réhabiliter dans son temps. Selon notre regard, le principe de développement durable n’est nullement né du Rapport Brundtland. Il est inscrit depuis la nuit des temps dans le cœur des Êtres humains. En effet, les générations présentes ont toujours eu vocation à transmettre un patrimoine aux générations futures. Dans cet objectif de transmission, les générations présentes et actuelles ne doivent pas scier la branche sur laquelle elles sont assises, de sorte qu’elles puissent transmettre aux générations futures la jouissance des ressources. En témoigne la gestion « en bon père de famille » devenue la gestion « raisonnable » depuis la Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Imposée aux générations présentes, la charge de conserver la substance de la chose matricielle, sans altération, conditionne la possibilité d’une transmission aux générations futures.
Générations présentes et générations futures sur le même bateau
Peut-on alors parler des fruits sans l’arbre qui les produit ? Peut-on se projeter vers les générations futures non nées sans faire état des générations présentes et actuelles ? Notre passé judéo-chrétien revient alors à la charge. Fruits de nos entrailles, ce sont bien les générations présentes qui engendrent des générations futures dont elles sont garantes. En accentuant la métaphore, nous pourrions observer que les générations futures sont les « fruits » des générations présentes. Oui, la Vie ne naît pas d’une génération spontanée. En clair, sans génération présente, pas de génération future. Il est alors heureux de constater que le droit cite les générations futures au côté des générations présentes qui les génèrent.
La dimension normative du droit a tout à fait compris ce positionnement qui a conquis l’ensemble de l’ordonnancement (art. 3§1, CCNUCC 1992 ; Consid. 45, Règlement n°2021/947 ; art. L. 110-1-I, Code de l’env.). Désormais placé au sommet de la hiérarchie des normes, le principe des équités générationnelles s’est frayé un chemin dans notre Constitution et est aujourd’hui clairement consacré (Consid. 7, Charte de l’env. 2004).
À l’instar de ce célèbre adage voulant qu’il faille éviter de mettre la charrue avant les bœufs, il semble vain de se projeter sur les tenants et aboutissants les générations futures en éludant l’état des générations présentes qui les engendreront. Cela veut-il dire que les générations présentes et actuelles ont la primauté sur les générations futures encore inexistantes. Cela en a tout l’air, car les générations présentes n’ont pas la même portée juridique que les générations futures au niveau, d’une part, du droit Objectif et, d’autre part, des droits subjectifs.
On appelle « droit Objectif » l’ensemble des règles de droit sanctionnées par l’autorité publique qui régissent la vie en société organisée, notamment, par le bloc de constitutionnalité. On nomme « droits subjectifs » les prérogatives attribuées à un individu – dans son intérêt – lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur, ou d’exiger par ces dernières d’autrui une prestation. Parmi les droits subjectifs, on retrouve par exemple le droit de propriété. Or, les générations futures et encore inexistantes ne sauraient se prévaloir ni de droit Objectif, ni de droits subjectifs. Une différence de taille.
La différenciation juridique entre les générations présentes et actuelles à distinguer des générations futures non nées
Bien que les générations présentes et actuelles puissent se prévaloir de pertes de biens et services par suite des dommages dus aux changements climatiques, les générations futures et non existantes ne le peuvent. Comme en témoigne cette décision de justice qui acte – en toute souplesse – la perte de bien et service consécutivement à l’érosion littorale du fait des changements climatiques sans indemnisation, c’est l’aliénation du droit Objectif et des droits subjectifs touchant les générations présentes qui s’étendra ensuite aux générations futures (Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018). Le droit de propriété est un témoin privilégié de cette observation. Il va de soi que vous n’allez pouvoir transmettre aux futures générations un bien rongé par les assauts de la mer dont on vous a déjà privé. Contrairement aux générations présentes et nées, les générations futures et encore inexistantes ne sont nullement titulaires de biens et services.
N’y a-t-il pas un ver dans le fruit quant au fait d’associer les générations présentes et futures en un seul tenant alors que ces dernières ne jouissent ni de droit Objectif, ni de droits subjectifs ? Une clarification se devait alors d’intervenir par une jurisprudence remarquable qui est venue apporter la lumière sur la portée du principe des équités générationnelles.
Il est des pays en Europe où la séparation des pouvoirs ne fait aucun doute, l’Allemagne en fait partie. Outre sa décision remarquée en matière d’économie, la Cour allemande de Karlsruhe est venue clarifier les tenants et les aboutissants du principe des équités générationnelles. Dans cette espèce, les requérants – qui se composent de plusieurs jeunes activistes, soutenus par des associations de défense de l’environnement – soutiennent que la Loi de programmation des objectifs climatiques dite « Klimaschutzgesetz » (Loi fédérale de protection du climat « Bundes- Klimaschutzgesetz ») manque d’ambition à satisfaire la neutralité climatique pour 2030 (Règlement (UE) 2021/1119). Au titre de la séparation des pouvoirs, si la Cour ne reproche pas au législateur l’insuffisance de réduction des émissions de GES prévue dans ladite Loi, elle s’interroge cependant sur les probables et gigantesques restrictions qui s’imposeront aux générations futures, postérieurement à 2030. Si la Cour statue en indiquant que la Loi fondamentale Klimaschutzgesetz est insuffisante à satisfaire les objectifs climatiques, et qu’elle est de nature à porter préjudice aux générations futures, elle indique néanmoins que les « générations futures toutes entières (…) ne sont pas titulaires de droits subjectifs consacrés par les droits fondamentaux » (point. 109). Selon les termes de la Cour, « [c]ette obligation de protection intergénérationnelle est toutefois de nature purement objective, étant donné que les générations futures ne peuvent, ni dans leur ensemble ni en tant que notion recouvrant la totalité des individus qui vivront alors, être considérées comme étant actuellement titulaires de droits fondamentaux » (point. 146).
En somme, la Cour démembre le principe des équités générationnelles en deux : les générations présentes et actuelles qui sont effectivement titulaires de droits fondamentaux, à distinguer des générations futures qui ne sauraient s’en prévaloir.
Mais c’est sur un autre aspect que la Cour de Karlsruhe a fait preuve d’une remarquable innovation juridique. Pour compenser l’absence de droits fondamentaux dont ne sauraient se faire prévaloir les générations futures, la Cour conçoit « un devoir de protection également à l’égard de générations futures » (point 146).
N’est-ce pas une manière détournée d’attribuer – par ce devoir de protection – des droits aux générations futures ? Et d’ajouter que ce devoir de protection aille « de pair avec l’impératif de prendre soin des fondements naturels de la vied’une manière qui permette de les léguer aux générations futures dans un état qui laisse à ces dernières un choix autre que celui de l’austérité radicale si elles veulent continuer à préserver ces fondements ». Ainsi, par l’intermédiaire d’un devoir de protection édicté par la Loi Klimaschutzgesetz (art. 20-a), la Cour garantit l’accès et la jouissance à des fondements naturels de la Vie, ou plus généralement le droit de vivre dans un environnement et un climat sain respectueux de la santé humaine.
En d’autres termes, si les générations futures ne peuvent se prévaloir ni de la perte de biens et services, ni d’être titulaires de droits fondamentaux, la Cour leur octroie ces droits de manière indirecte en imposant à l’État un devoir de protection.
Ainsi que nous l’avons argumenté, bien que les générations présentes et actuelles aient la primauté, elles ont malgré tout un devoir de protection qui leur incombe vis-à-vis des générations futures et non nées.
Le devoir de protection surgit alors comme un moyen remarquable de marier les générations présentes aux générations futures pour former le principe des équités générationnelles.
Références
Art. 578, Code civil : « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ».
BRUNDTLAND G.H., « Our common future—Call for action », Environmental conservation, 14, no 4, Cambridge University Press, 1987, p. 291‑94.
Entrée « Fructus » : « Mot latin désignant l’un des trois attributs du droit de propriété sur une chose, le droit d’en percevoir les fruits, au sens large du terme, sans altération de la substance de la chose » ; DEBARD T. et GUINCHARD S., Lexique des termes juridiques 2019-2020, 27ième édition, Dalloz, 2020, p. 515.
GAILLARD E., Générations futures et droit privé : vers un droit des générations futures, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », 2011.
Loi fédérale de protection du climat « Bundes- Klimaschutzgesetz », 24 mars 2021, 1 BvR 2656/18, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20.
Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, dans JORF n°0179 du 5 août 2014.
Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique, dans OJ L, vol. 243, 2021.